Le concours de nouvelles organisé par BoD et Théo Lemattre a compté 118 participant·e·s. L’heure des résultats a sonné !
Le thème était « Quand le temps s’arrête » et les textes reçus ont bluffé notre jury composé de BoD, Théo Lemattre, Marie-Haude Mériguet, Tamara Balliana et Sébastien Théveny.
Sans plus attendre, voici les résultats de leur délibération :
Les lauréat·e·s du concours « Quand le temps s’arrête »
1er lauréat·e : Timéo Carnon et sa nouvelle « Le Poème »
Timéo Carnon écrit des thrillers écologiques et des romans d’aventure pour les 12-15 ans, mêlant mystère, aventure, corruption et écologie. Diplômé en ethnologie et passionné de voyages, il aime explorer les cultures, écouter les récits locaux et s’émerveiller devant la richesse du monde. Ces expériences humaines nourrissent son imagination et donnent naissance à des histoires qu’il partage avec enthousiasme à travers ses livres. Vous pouvez suivre son parcours d’auteur sur Instagram :@timeocarnon
Le jury a salué l’ambiance “chabrolienne” de sa nouvelle, nourrie de références littéraires et d’un champ lexical du temps maîtrisé. Sa morale fine où la suspension du temps révèle l’émancipation du personnage…
Timéo Carnon remporte donc une liseuse Kobo Clara Colour, un abonnement Premium d’un an à la plateforme WriteControl ainsi qu’une formule BoD Publication.
2e lauréat·e : Isabelle Riquet et sa nouvelle « Huit minutes »
Aux yakuzas qui se transforment en loups-garous, Isabelle Riquet préfère les personnages qui mènent des batailles intérieures. Autrice de nouvelles et de romans, elle écrit à partir du réel pour explorer des sujets sensibles et les silences de l’histoire. Vous pouvez suivre son parcours d’autrice sur Instagram :@labibtrotteuse
Une nouvelle brillante qui nous a séduits par son souffle romanesque, son style irréprochable et très vivant. L’aspect “fait réel” de la narration est particulièrement poignant !
Isabelle Riquet remporte une formule BoD Publication et le « kit essentiel de l’auteur BoD » pour 2026.
3e lauréat·e : Anaïs Célesta et sa nouvelle « 7007 secondes »
Anaïs Célesta est autrice et explore dans ses textes les instants où le temps vacille.
Elle écrit sur la mémoire, l’absence, les émotions brutes et les silences qui disent plus que les mots.
Entre fiction et intime, son écriture cherche à toucher juste, sans détour.
« 7007 secondes » s’inscrit dans cette démarche sensible et profondément humaine. Vous pouvez suivre son parcours d’autrice sur Instagram :@anais_celesta
Ce troisième texte a convaincu le jury grâce à son style magnifique et une narration d’une grande finesse.
Anaïs Célesta remporte une formule BoD Publication et le « kit essentiel de l’auteur BoD » pour 2026.
Les nouvelles des trois lauréat·e·s
« Le Poème » de Timéo Carnon
Sa mère l’avait prénommée Mathilde, comme l’héroïne du roman qu’elle avait lu à quinze ans. Depuis, elle s’était identifiée à cette Mathilde-là — belle, passionnée, incomprise. Mais personne ne l’appelait plus par son prénom depuis des années. On disait « Madame Valmont » dans les salons, ou « ma chère » dans la bouche de son mari, et rien du tout le reste du temps.
Elle avait bientôt quarante ans, ce qui n’est rien pour une femme qu’on admire, mais beaucoup pour une femme qui a cessé d’exister. Car c’était cela, le pire : elle avait disparu. Par petites touches, par abandons successifs, par une suite de renoncements qu’elle n’avait pas vus venir.
D’une beauté délicate, elle avait ce regard un peu rêveur que les hommes aimaient chez les jeunes filles de bonne famille. On la disait « distinguée », ce qui signifiait : convenable pour un bon mariage. Et de fait, elle avait été mariée à vingt ans, comme il se doit, à un homme plus âgé, issu d’une famille respectable et fortunée.
Elle avait cru, alors, que sa vie commencerait. Qu’elle recevrait des artistes, des écrivains, qu’elle voyagerait peut-être. Elle avait des rêves légitimes. Juste le désir d’être vue, entendue, considérée. Rien de tout cela n’était arrivé.
Alors elle avait écrit. En secret. Des poèmes qu’elle cachait dans sa coiffeuse, sous des mouchoirs brodés. C’était son jardin secret, son refuge.
Monsieur Valmont, son mari, était un homme qui avait réussi. Cinquante-six ans, une carrure épaissie par les banquets, une réputation honorable dans les cercles bourgeois de la ville.
Il aimait sa femme, mais à sa manière. C’est-à-dire qu’il la trouvait décorative, qu’il appréciait qu’elle sache tenir une maison, qu’elle ne lui fasse jamais de scènes. Il ne comprenait pas cette mélancolie qui, parfois, passait dans son regard.
« Varium et mutabile semper femina » aimait-il à dire, citant Virgile. Et cela lui suffisait comme explication.
Ce qu’il aimait au plus haut point, c’était briller en société. Raconter des anecdotes, lancer des bons mots, monopoliser l’attention. Il avait ce besoin de reconnaissance, cette faim de regards tournés vers lui.
Il se voyait comme un bon vivant, un peu moqueur peut-être, mais sans méchanceté. Il ne cherchait jamais à blesser. Simplement, il ne voyait pas que derrière chaque rire qu’il provoquait, quelqu’un pouvait souffrir.
Ce soir-là, quand il trouva ce poème, il ne pensa pas une seconde à la blessure qu’il allait infliger.
Il pensa : « Voilà qui va les faire rire. »
*
Comme tous les premiers samedis du mois, les Valmont recevaient. C’était une tradition. Quinze convives : le notaire Dufresne et sa femme, le docteur Moreau, le député Chavignac, des industriels prospères, leurs épouses parées de bijoux et de sourires convenus, et dont les rires sonnaient comme des cloches fêlées.
Le repas avait duré trois heures. Elle, n’avait presque rien dit. Lui, au contraire, occupait chaque centimètre de l’espace. Il parlait fort, riait plus fort encore, levant le verre à chaque anecdote. Le col de chemise légèrement ouvert, la cravate défaite avec une nonchalance étudiée, il savourait son rôle de maître de maison. Tout tournait autour de lui, comme un système solaire autour de son astre.
« Ding », le tintement sec du manche de cuillère qui venait de frapper le verre, la fit sursauter…
— Mes amis… lança-t-il. Avant de passer au digestif, permettez-moi un petit divertissement.
Il plongea la main dans la poche de son gilet, en sortit une feuille délicatement pliée, qu’il agita comme un trophée.
— Regardez ce que j’ai trouvé !
En reconnaissant la feuille, Mathilde sentit sa poitrine se serrer comme prise dans un étau. Non. Pas ça, pensa-t-elle, le rythme de son cœur s’accélérant comme un cheval au galop.
Mais déjà, il dépliait la feuille et souriait avec cette assurance qui précédait ses meilleurs effets.
— Figurez-vous, dit-il, que j’ai découvert que ma chère épouse… écrivait des poèmes !
Un murmure parcourut la table. Des sourires amusés. Des regards curieux qui se tournèrent vers elle.
Elle baissa les yeux.
Il s’éclaircit la voix et commença à lire.
— « Quand la nuit descend sur mes épaules nues… »
Une femme un peu plus éméchée que les autres pouffa. Lui, s’en trouva galvanisé. Il reprit, exagérant la diction, roulant les « r », soupirant dramatiquement à chaque vers.
Elle sentit la chaleur lui monter au visage. Ses mains devinrent glacées. Ses oreilles bourdonnaient. Sa vision se troublait légèrement. La honte l’avait envahie de la tête aux pieds. La table sembla s’éloigner, les rires se déformer. Elle voyait les lèvres bouger mais n’entendait plus qu’un murmure étouffé.
Un serveur s’était approché pour resservir du vin. Elle vit son bras se tendre vers le verre d’un invité. La carafe bascula légèrement. Une goutte rouge se détacha du goulot… très lentement.
Elle cligna des yeux. La goutte descendait doucement.
Les voix autour d’elle s’étiraient, devenant graves, lentes, comme un tourne-disque qui ralentit. Le rire du mari prit une tonalité monstrueuse. Les visages se déformaient dans une lenteur irréelle. Puis tout s’immobilisa.
La goutte resta suspendue en l’air, parfaitement immobile, comme un rubis liquide que la lumière des bougies traversait de part en part.
Les voix se turent. Les visages se figèrent. Le temps s’était arrêté. D’un coup.
Un silence brutal avait enveloppé toute la pièce, et tous semblaient pétrifiés. Un convive la tête renversée, immobilisé dans un rire grossier. Une femme, les yeux mi-clos, l’air embarrassé, interrompue dans son soupir. Le serveur, penché, la bouteille inclinée, avec la goutte suspendue dans l’air, prête à tomber. Le mari, bouche ouverte, bras levé, dans un geste théâtral, ridicule.
Elle se redressa lentement. Sa chaise grinça avec un son terriblement aigu dans ce silence total. Elle se leva. Ses jambes tremblaient légèrement. Ses pas sur le parquet produisaient un écho qui semblait se perdre dans l’immensité du salon. Elle fit le tour de la table.
Chaque visage prenait une dimension nouvelle dans cette immobilité parfaite. Des faces pétrifiées, grotesques, prises au piège de l’instant.
Le notaire Dufresne, bouche béante sur un rire gras, ressemblait à une gargouille de cathédrale. Ses bajoues pendantes, sa calvitie luisante sous les chandelles – tout cela qui, en mouvement, composait un personnage respectable, devenait soudain pitoyable. Madame Moreau avait les yeux brillants de larmes – de rire, probablement. Mais figées ainsi, ces larmes ressemblaient à celles du chagrin. Elle parut soudain vieille, fatiguée, comme si l’immobilité révélait ce que le mouvement cachait. Le député Chavignac, penché vers son voisin, gardait sur la face cette expression de connivence masculine, ce sourire entendu qui suggérait une plaisanterie salace. Statufié ainsi, il paraissait vulgaire, répugnant.
Elle continua son parcours. Observant chaque convive comme on observe des tableaux dans un musée. Une femme, au fond, avait les yeux baissés vers son assiette, comme si elle refusait de participer. Mais elle n’avait rien dit. Elle n’avait pas protesté. Personne n’avait eu ce courage-là. Elle sentit ses poings crispés, ses lèvres serrées, sa bouche sèche, son front tendu. La honte s’était métamorphosée en une colère froide. Elle avait envie de hurler.
Ses yeux tombèrent sur le couteau à viande. Long, fin, effilé. La lame tranchante et le manche nacré. Elle le saisit d’un geste si vif qu’elle sentit ses ongles crisser sur la nappe.
Elle se tourna vers son mari. Il était là, à quelques pas, grimaçant dans sa posture incongrue. La feuille froissée dans la main. Ce sourire carnassier qui lui fendait le visage s’était transformé en un rictus ignoble. Elle s’approcha et s’arrêta face à lui. Elle ne vit qu’un homme vieillissant. Les rides autour des yeux. Les cheveux gominés qui ne cachaient plus vraiment le crâne dégarni. Le ventre qui tendait le gilet. Les mains épaisses qui tenaient ce papier délicat comme un trophée.
Elle plaça le couteau en travers de sa gorge. Le couteau s’enfonça légèrement, suffisamment pour laisser une marque invisible. Juste assez pour sentir la fragilité de ce cou, la vulnérabilité de cette chair. Elle resta ainsi, immobile, le couteau contre la gorge de son mari.
Les secondes passaient – ou ne passaient pas, comment savoir dans ce temps suspendu ? Elle fixait ce rictus qui déformait son visage pathétique, grossier.
Puis quelque chose se déplia en elle. Elle comprit.
Voilà ce qu’elle comprit. Son mari, ce tyran domestique, cet homme qui la faisait disparaître à petit feu, n’était qu’un homme pitoyable dans son besoin de dominer. Un homme qui avait besoin de rire des autres pour exister. Un homme qui pensait s’élever en rabaissant les autres.
Un pantin misérable.
Elle recula d’un pas et reposa le couteau sur la table. Doucement. Le métal tinta légèrement contre une porcelaine. Elle s’approcha d’une fenêtre. Dehors, le temps s’était arrêté aussi. Un oiseau suspendu en plein vol, ailes déployées. Une feuille morte arrêtée dans sa chute. Le vent lui-même semblait avoir retenu son souffle.
Le monde entier était en apnée.
Elle posa sa main contre la vitre. Le verre était froid sous sa paume. Réel. Solide. Elle respira. Profondément. Lentement. Comme on redécouvre l’air après une suffocation.
Dans ce silence absolu, dans ce temps suspendu, quelque chose en elle resurgit.
Quelque chose qu’elle croyait mort depuis longtemps : son propre souffle.
Elle tourna le dos à la fenêtre. Balaya le salon du regard. Toutes ces statues de chair. Elle n’avait plus peur d’eux. Elle n’avait plus honte. Elle retourna lentement à sa place. Reprit exactement la même position : mains posées sur ses genoux, dos droit, visage impassible. Elle inspira une dernière fois. Profondément. Comme avant un plongeon. Et elle ferma les yeux.
*
Le temps se remit en marche.
D’un coup, comme si quelqu’un avait appuyé sur un interrupteur.
La goutte de vin acheva sa chute, éclaboussa la nappe en une petite étoile rouge. Les rires reprirent, tonitruants. Le député tapa du poing sur la table. Les verres tintèrent. Le serveur termina de verser le vin, imperturbable. Le mari continuait de déclamer avec un rire qui détonna étrangement, comme un écho venu d’un autre monde.
Elle, immobile, le regarda sans trembler.
Il voulut continuer. Sidéré par le regard de sa femme, le texte lui échappa. La feuille glissa sur la table. Il se mit à bégayer.
Elle releva légèrement le menton. Sa voix, calme, coupa la pièce en deux.
– Quelle horreur ! Tu lis très mal, tu sais. Tu n’as peut-être pas tout compris. Ça ne rend vraiment pas hommage à ce merveilleux poème…
Silence. Les convives se regardèrent, interdits. Le mari cligna des yeux, perdu, comme frappé par un coup invisible.
Elle posa sa serviette, se leva.
– Je vais prendre l’air, dit-elle simplement.
Elle ne baissa pas les yeux. Ne détourna pas le regard. Elle le fixait calmement, intensément, avec une tranquillité qui ressemblait à une indifférence mêlée de mépris. Il détourna le regard le premier. Mal à l’aise, cherchant refuge dans son verre de cognac.
C’était tout. Pas d’accusation. Pas de cri. Pas de pleurs. Juste ces mots, prononcés avec une dignité absolue.
Elle contourna la table. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Comme si le temps s’était de nouveau suspendu. Seul le bruit de ses pas résonnait sur le parquet.
Son mari voulut se lever. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais aucun son ne sortit. Peut-être avait-il compris, confusément, qu’il n’y avait rien à dire.
Arrivée dans le vestibule, elle s’arrêta devant le grand miroir qui faisait face à l’escalier. Seul un chandelier jetait une lumière tremblante sur les murs lambrissés. Dans la pénombre, son reflet la regardait. Une femme en robe de soie gris perle. Un chignon impeccable. Des mains fines et un joli port de tête.
Ce n’était plus la même femme. Les yeux, surtout, brillaient d’une lueur nouvelle. Quelque chose de dur. De libre. De vivant. D’un geste précis, elle dénoua son chignon, laissant ses cheveux flotter librement sur ses épaules. Elle se regarda longuement. Comme pour mémoriser ce visage. Cette femme : Mathilde, qu’elle venait de retrouver.
Dehors, la nuit l’attendait. Froide. Immense. Libre.
Le vent soufflait à travers les arbres du parc, faisant bruisser les feuilles comme une respiration géante. Le ciel était criblé d’étoiles.
Elle descendit les marches du perron. Une rafale la saisit sauvagement, lui arrachant un petit rire bref, presque enfantin. Elle sentit le froid mordre ses épaules nues.
Elle inspira profondément. L’air emplit ses poumons, glacé, vivifiant, brûlant. Derrière elle, dans le salon illuminé, on entendait des murmures. Des voix embarrassées. Quelqu’un toussait. Une chaise raclait le parquet.
Elle ne se retourna pas.
« Huit minutes » d’Isabelle Riquet
16 juin 1944, prison d’État de la Caroline du Sud. Dans une salle trop petite pour le monde qui y est entassé, quatre hommes et un prêtre entourent un condamné à mort. En tant que responsable du département du couloir de la mort, il me revient de présider ce moment fatidique. D’une voix que je voudrais claire, mais que l’émotion étrangle, j’énonce la condamnation du détenu :
– Georges Stinney Junior, né le 21 octobre 1929 à Pinewood. Reconnu coupable de meurtre au premier degré par un tribunal de l’État, vous êtes condamné à la peine capitale, à savoir la mise à mort par électrocution, jusqu’à ce que mort s’ensuive, sans possibilité d’appel ni de commutation. Que Dieu ait pitié de votre âme.
À l’issue de cette longue et douloureuse lecture, Georges hoche la tête et mon cœur se brise un peu plus. Sa complexion sombre blêmit sous l’effet de la peur qu’il cherche à maîtriser. Ce n’est pourtant pas mon genre de pleurer un détenu, afro-américain de surcroît, mais comment faire autrement lorsque celui qui se trouve sous mes yeux a quatorze ans ? Le tableau est aussi absurde que morbide : un petit gabarit, installé à la va-vite sur un instrument de mort trop grand pour lui, au point qu’il a fallu nouer les sangles pour les adapter à sa taille. Et lorsque j’aperçois la Bible qui sert de réhausseur pour le siège1, je manque de rire jaune. À côté de moi, un collègue me couve d’un regard anxieux, l’air de se demander si je suis sain d’esprit. Comment le rester lorsque mon travail consiste à mettre à mort un enfant ?
– C’est l’heure, me glisse-t-il discrètement pour me tirer de ma léthargie.
Je jette un œil à ma montre, cassée, puis à l’horloge de la salle dont les aiguilles, totalement immobiles, indiquent une heure improbable. Je lui adresse alors un regard dubitatif : comment peut-il savoir que c’est le moment ? Mon collègue se contente de montrer Georges en guise de réponse. Terrorisé, le petit n’arrive plus à retenir ses larmes. Ses yeux se posent tour à tour sur les visages hostiles des adultes présents dans cette salle, une supplique silencieuse au fond des pupilles. Personne ne va l’aider. Surtout pas le gouverneur qui a pourtant le pouvoir de suspendre l’exécution d’un coup de fil. Mais le téléphone accroché au mur, qui nous relie à sa ligne directe, reste désespérément silencieux. Tout comme les cliquetis inexistants de l’horloge en panne.
Je me suis voilé la face suffisamment longtemps. Aucun miracle ne viendra et je ne peux pas prolonger l’agonie de ce pauvre garçon. D’un pas rapide, je m’approche de lui pour ajuster à son visage le masque qui ne cesse de tomber. D’instinct, il recule sa tête autant que le dossier du siège le lui permet.
– N’aie pas peur. C’est pour ton bien.
Mensonge. C’est pour le nôtre et celui des témoins. La mort par électrocution peut provoquer des réactions corporelles spectaculaires qu’il est préférable de cacher avec ce masque, mais j’essaye juste de rassurer le gosse.
– Ça va faire mal ? me demande-t-il d’une petite voix.
Je force mes lèvres à s’étirer légèrement mais, à l’intérieur, mon cœur est aussi creux et sec qu’un arbre mort.
– Pas plus d’une minute. C’est une méthode rapide et sans douleur.
C’est ce qu’avait dit son inventeur, Thomas Edison, mais il n’avait jamais expérimenté lui-même sa méthode d’exécution et, depuis son invention, bien des condamnés en avaient souffert. Normalement, une première salve de vingt secondes les assomme, puis la seconde, un peu plus longue, les tue. Georges doit recevoir le même traitement. Je n’ai pas le droit à l’erreur.
Lorsque je regagne ma place, tout est fin prêt pour commencer l’exécution. J’exhale lentement par le nez. Pas plus d’une minute. Je le lui ai promis.
La mort dans l’âme, je hoche la tête pour donner le signal. Le levier se lève. Le corps de Georges tressaute presque aussitôt.
Une minute, qui ressemble plutôt à une éternité, me laissant le temps de penser à la suite d’événements qui m’a conduit à être complice de ce meurtre institutionnel.
Dès son arrivée, trois mois plus tôt, j’ai su que Georges était innocent. Le scénario n’était vraiment pas difficile à deviner : le gamin qui était au mauvais endroit au mauvais moment, que la justice avait pourtant choisi d’immoler sur son autel pour donner l’impression de bien faire son travail.2 Ce n’était pas le premier, mais c’était de loin le plus jeune.
Alors, je n’ai pas pu m’empêcher de le regarder malgré moi avec curiosité, de questionner la raison de sa présence dans le couloir de la mort.
– Tu t’es gouré, John. La garderie, c’est pas ici.
– T’es con ! C’est ton nouveau pensionnaire.
– Mais c’est un môme ! On m’avait pas prévenu qu’on condamnait les mineurs maintenant.
– Il a quatorze ans. Tu sais très bien que légalement, il peut être jugé comme un adulte à cet âge.
– Tu vas pas me faire avaler que ce gamin a fait quelque chose de grave !
– Il a tué des fillettes de sept et onze ans. Il l’a avoué le jour même de son arrestation.
En entendant le chef d’inculpation de Georges, je l’ai regardé avec des yeux ronds. J’avais du mal à faire le lien entre l’adolescent chétif qui se tenait humblement entre nous, et les faits qui lui étaient reprochés. Cet étonnement a aussi surpris mon collègue, qui ne m’avait jamais vu recevoir un prisonnier avec autant de réticence.
– On fait ce boulot depuis quinze ans, Rich’. Tu sais comme moi que la monstruosité peut prendre des formes très diverses. Surtout chez eux.
Admettons. Mais tous les détenus qu’on m’a amenés ici avaient quelque chose dans le regard qui, au fond, justifiait leur présence entre les murs du couloir de la mort. De la culpabilité ou de la folie. Je ne voyais rien de tel chez cet enfant qui gardait sa tête rentrée dans les épaules, comme si nous étions les monstres dont il essayait de se protéger. Malgré cela, un fonctionnaire est chargé d’exécuter et non de penser. Alors j’ai remercié mon collègue et endossé mon rôle de gardien auprès de cet étrange détenu.
– Ton nom ? j’ai demandé sans préambule.
– Georges Stinney Junior, Monsieur, a-t-il répondu d’un ton docile.
– Très bien, Georges. Je vais t’expliquer comment ça se passe ici.
Et tandis que je lui énonçais le règlement et les sanctions encourues s’il s’avisait de causer du grabuge, Georges se contentait de hocher timidement la tête à chacun de mes avertissements, comme si la politesse pouvait encore le sauver de l’inévitable. Durant tout le temps qu’a duré sa captivité, sa douceur enfantine n’a jamais cessé de me surprendre et de me mettre mal à l’aise. C’est ce qui la rendait si pénible à vivre en tant que gardien.
Un jour, pour attirer mon attention, il a levé le doigt comme si nous étions en classe, et non dans l’antichambre de la mort :
– Monsieur ! Est-ce qu’on a des droits de visite, ici ?
– Tu n’en as le droit qu’à une seule, la veille de l’exécution.
Je me suis mordu la langue en le voyant s’affaisser sur lui-même. La réponse est sortie machinalement avant même que je ne me rappelle qui l’avait posée. Dans un silence gêné, j’ai cherché une solution pour ragaillardir ce môme qui gisait sur sa couchette, le regard éteint.
– Si tu veux, je peux appeler ton avocat pour voir ce qu’on peut faire pour toi. Parfois, il y a des dérogations, j’ai proposé d’un ton hésitant.
– J’en ai pas, a répondu le garçon, avant de se tourner vers le mur de sa cellule.3
Bien évidemment, personne n’était venu le voir la veille du grand jour. Le juge s’y était opposé au motif de préserver l’ordre public. Pas plus qu’il n’avait eu de compagnie pour son dernier repas. Seul le pasteur s’était déplacé pour l’assister dans ses dernières heures de vie. Personnellement, je n’avais pas pu me résoudre à créer du lien avec ce gosse comme je le faisais d’habitude avec d’autres détenus. Georges était le seul pour lequel, ironiquement, j’avais respecté le protocole de la prison. La pensée que j’allais être responsable d’une mort cruelle m’empêchait d’agir autrement. Neuf semaines se sont ainsi écoulées entre silences pesants et interactions maladroites, au point que j’en venais parfois à souhaiter égoïstement que le jour de l’exécution arrive enfin. Généralement, je me contentais de l’observer de mon bureau se distrayant avec le moindre bout de ficelle ou motte de poussière qui lui tombait sous la main. Je n’ai jamais été aussi productif dans ma gestion de la paperasse administrative que lorsque Stinney était parmi nous. Mais lorsque le travail me faisait défaut, lorsque j’étais contraint de faire mes rondes en croisant le regard apeuré et curieux de ce garçon, les heures semblaient soudainement s’étirer. Paradoxalement, malgré son appréhension, Georges semblait rechercher ma compagnie en me posant des questions ou en émettant des remarques anodines auxquelles je répondais à peine. À la longue, il avait fini par s’habituer à mon mutisme borné et se contentait de suivre des yeux mes allées et venues. Pour lui comme pour moi, le temps se mesurait au nombre de passages que j’effectuais dans le corridor, mais il revêtait une signification différente. Je l’ai appris à mes dépens, un matin, alors que mes piétinements me faisaient passer pour la énième fois devant sa cellule. Georges a osé demander :
– Quel jour sommes-nous ?
– Jeudi 31.
J’ai soupiré en lui répondant, me languissant après le week-end qui tardait à venir, mais la réaction du gosse m’a brutalement fait relativiser :
– Déjà !
Devant le regard alarmé du petit, j’ai dégluti tout en me traitant de connard en pensée. Ce que j’attendais avec impatience, Georges le redoutait par-dessus tout. À ce moment-là, il ne lui restait plus que deux semaines à vivre. Alors j’ai baissé les yeux, honteux, et j’ai repris ma marche le long du couloir.
Je suis plus responsable de la mort de Georges que n’importe qui. Tout ce temps, j’ai préféré le petit confort de ma lâcheté à la criante vérité qui brillait dans son regard innocent. Même alors que j’allais le chercher dans sa cellule, le pas traînant, je me suis convaincu que je faisais simplement mon travail, que refuser de l’exécuter n’aurait causé que le report de l’inéluctable. Quand la machine infernale qu’est la justice se met en marche, elle écrase tout sur son passage.
Toutes ces excuses m’apparaissent minables à présent que je découvre le visage d’un enfant cuire sous l’effet de l’électrocution. Une fois de plus, le masque n’a pas tenu. Il ne cache plus rien de l’horrible spectacle auquel nous assistons, ni les yeux qui se révulsent, ni les cloques qui éclatent sa chair délicate, ni même les canaux de ses narines qui explosent, maculant de sang sa bouche et le col de sa tunique. Les dents serrées, je lutte désespérément pour ne pas laisser mes jambes s’effondrer. Normalement, il devrait être mort à présent.
Une minute, pas plus.
C’est ce que je lui avais promis. Mais alors que le temps m’échappe — plus d’horloge, plus de certitude — je m’accroche à ce qu’il reste : les signes du corps qui lâche.
Lorsque je donne enfin l’ordre d’abaisser le levier du générateur, le médecin se précipite vers le corps de Georges pour l’examiner. Son regard exprime d’abord la confusion, puis le découragement. Il secoue la tête de gauche à droite dans ma direction.
Il faut recommencer.
– Encore ! je lance tel un automate, et la frêle silhouette se remet à convulser.
À l’intérieur, je suffoque. Les décharges se succèdent et la Mort refuse de prendre Georges. Me voilà condamné à répéter l’ordre d’exécution avec autant de ferveur qu’un croyant qui égrène son chapelet.
Faites que ça s’arrête. Vite.
Finalement, huit minutes plus tard, son cœur a cessé de battre — et le mien avec. Le médecin confirme l’heure de la mort : dix-neuf heures quatorze.
À partir de là, le protocole d’exécution reprend avec minutie : on me tend le registre de décès où apposer ma signature aux côtés de celles des témoins et du docteur. La mienne bave sur le papier. Ce n’est qu’une formalité administrative.
Une de plus. Une de trop.
Pendant ce temps, on emporte le corps sans vie de l’adolescent sur une civière, recouvert d’un drap rêche en guise de linceul. Ce soir, il reposera dans la morgue du pénitencier. Les vivants, eux, s’empressent de s’en aller maintenant que tout est fini. Telle une ombre silencieuse, je les suis, oubliant volontairement mon insigne dans la salle où est mort mon dernier condamné.
Dehors, les cœurs sont à la fête. L’air estival et la fragrance des fleurs saluent une victoire qu’on attendait depuis longtemps. On parle de paix, de justice retrouvée, d’un monde meilleur. L’humanité a triomphé de la barbarie et de l’obscurantisme.
Mais, ici, elle a attaché un enfant noir à une chaise, avant de l’oublier.
En passant devant moi, un collègue me signale que l’horloge en panne de la salle d’exécution est réparée. Ses aiguilles se sont remises spontanément à bouger. Le temps a repris ses droits.
Ma montre, elle, est toujours arrêtée.
1 Ou un annuaire téléphonique. Les sources ne concordent pas sur la nature du document, mais un livre a bien fait office de réhausseur pour asseoir Georges Stinney sur la chaise électrique.
2 Georges Stinney a été arrêté parce que les corps des victimes, Betty Binnicker et Mary Thames, ont été retrouvés près du domicile familial. Pour ne rien arranger, l’adolescent était également le dernier à les avoir vues en vie.
3 En réalité, Georges Stinney avait bien un avocat, puisque tout accusé a droit à une défense, mais sa présence était purement symbolique : l’avocat ne plaida pas, n’appela aucun témoin et n’entreprit aucune démarche pour contester la sentence.
À la mémoire de Georges Stinney Jr.
« 7007 secondes » d’Anaïs Célesta
Je ne sais plus quand j’ai commencé à entendre le silence respirer.
Au début, c’était un détail. Une chose infime qui se coinçait dans la gorge du temps, un hoquet discret entre deux tic-tac. La pendule de la cuisine indiquait dix-neuf heures sept quand la vapeur de la bouilloire s’est figée au-dessus de la tasse. J’ai cru à une panne. La flamme du gaz, tendue comme une lame bleue, ne vacillait plus. Dehors, une mouette restait plantée dans l’air, ailes ouvertes, prête à piquer sur quelque chose que je ne verrais jamais. Et puis j’ai entendu des pas dans le couloir.
Ses pas.
Je n’étais pas prête. Je ne le suis jamais, même quand je fais semblant. J’ai posé la main sur la table pour ne pas tomber. Les pas ont traversé le parquet, le tapis, les tournesols dessinés sur le paillasson. Ils ont hésité au seuil du salon, là où l’ombre de la bibliothèque grignote un peu le mur. Et il est apparu.
Octave n’avait pas changé. Les cheveux en bataille, comme après un match sous la pluie. Il avait son sourire en coin, narquois. Je n’ai pas bougé. Lui non plus. Le monde était immobile, on n’entendait que le bruit léger de nos respirations.
– Salut, a-t-il dit.
Je n’ai pas répondu. J’ai pensé : si je parle, je me réveille, ou bien il disparaît, comme un rêve soufflé. J’ai pensé aussi que j’allais mourir maintenant, tout de suite, tranquillement, parce que rien d’autre n’avait de sens.
– Tu m’offres un thé ? a-t-il demandé.
J’ai éclaté de rire, un rire qui m’a coupée en deux. Mes genoux ont tremblé et j’ai attrapé la tasse figée dans l’air. Elle m’a obéi comme si de rien n’était, la vapeur s’est remise à couler à l’envers jusqu’à rentrer dans l’eau. La flamme a repris sa danse. Le monde, remis en marche, a continué sans se soucier de nous. La pendule marquait toujours dix-neuf heures sept.
Il s’est assis au bout du canapé et a tiré sur un fil de mon vieux plaid. Le fil a cédé avec un petit bruit, comme si le temps perdait une maille.
– Maman, a-t-il dit doucement, on n’a pas beaucoup de temps.
C’était la chose la plus cruelle et la plus juste qu’on me disait depuis un an.
Le soir suivant, à dix-neuf heures sept, la bouilloire a sifflé, la flamme s’est figée, la mouette a repris son poste dans l’air et j’ai compté mes respirations pour ne pas trembler. Il était de nouveau là. J’avais préparé deux tasses, deux cuillères, deux tranches de citron. Il a souri d’un air fier, comme un gosse qu’on attend à la sortie de l’école avec son goûter préféré.
– Tu as vu ? J’ai remis tes posters. On dirait que la mer entre dans la chambre.
– Tu as gardé ton tic, a-t-il répliqué, amusé. Quand tu es nerveuse, tu ranges comme si ça pouvait remettre les choses à leur place.
Nous avons parlé comme on marche sur une glace mince : en ne posant presque pas le pied. Il m’a raconté des choses minuscules, un rêve de vélo, le goût d’un bonbon au sel, la sensation de courir dans un terrain boueux. Je lui ai raconté des choses inutiles, la vie quotidienne.
– C’est bien, a-t-il dit. Continue à parler au monde.
– Comment je pourrais arrêter ?
Il a haussé les épaules, geste qui m’a rendu le souffle.
– Les vivants oublient. C’est plus facile.
Je ne l’ai pas contredit. À la place, j’ai pris sa main. Elle était tiède, solide, avec cette cicatrice pâle sur le pouce qui ne partait pas.
– Compte, a-t-il chuchoté.
– Quoi ?
– Compte dans ta tête. Juste pour voir.
Je l’ai fait. Un, deux, trois. Les chiffres ont coulé comme de l’eau. Arrivée à mille, il m’a arrêtée en riant.
– Tu comptes trop vite. Tu vas gâcher.
– Gâcher quoi ?
– Nos 7007 secondes.
Ce fut la première fois qu’il posa un chiffre sur le miracle. Le soir, après son départ, j’ai pris un stylo et j’ai écrit un grand 7007 au marqueur sur le calendrier, pour ne pas oublier.
Les jours d’après n’étaient plus des jours, mais des marches vers une porte. Je tenais la maison comme on tient un corps malade : doucement, mais avec cette tension qui finit par faire mal. À dix-neuf heures sept, la porte s’ouvrait et mon fils entrait. Je m’étais fabriqué un rituel avec de petits gestes idiots : deux tasses posées exactement face à face, le plaid plié, la radio éteinte. Je ne répondais plus au téléphone après dix-huit heures.
C’est là que j’ai commencé à oublier des choses.
D’abord c’était minuscule : le prénom de la boulangère. Puis le code de ma carte. Ensuite le bruit précis que faisait la pluie sur la véranda. Je l’entendais encore, mais je ne l’aurais pas reconnu parmi d’autres. À la place, le silence de dix-neuf heures sept prenait de la place.
Le soir, Octave a froncé les sourcils en voyant mon visage.
– Ça commence, a-t-il murmuré.
– Quoi ?
– Le prix.
J’ai secoué la tête trop vite.
– Non. C’est le manque de sommeil. Et puis le docteur a dit que…
– Tu n’as pas besoin de docteur, maman. Tu as besoin d’air.
– J’en ai ici.
– Non, ici, c’est entre deux respirations.
Il m’a pris les mains. Il avait ce sérieux qui m’a toujours subjuguée, comme s’il m’avait comprise avant moi.
– Je ne veux pas que tu payes le prix fort.
Je l’ai regardé sans comprendre. Il a souri avec ses yeux, enfin, et j’ai compris trop bien. Alors j’ai fait ce qu’on fait quand on refuse le vrai : j’ai proposé un jeu. Nous avons construit un bateau en papier avec un vieux magazine. Nous l’avons posé sur la table. À dix-neuf heures vingt-sept, quand tout s’est arrêté de nouveau de l’autre côté de la seconde, le bateau est resté là, figé au milieu d’un océan de bois. J’ai soufflé dessus. Il n’a pas bougé. Octave a ri et j’ai ri aussi.
La première fois que j’ai oublié mon prénom, ce fut dans un formulaire administratif. Case « NOM — Prénom ». J’ai écrit le nom et rien d’autre. Aucun mot ne venait. Je suis restée plantée là dix minutes à chercher mon propre prénom comme on cherche une boucle d’oreille dans l’herbe. Il ne revenait pas. J’ai fini par signer « maman » à la place, puis j’ai déchiré la page et j’ai ri un peu trop fort.
Le soir, je l’ai dit à Octave. Il a baissé la tête et a tourné le bateau de papier dans ses doigts.
– On ne peut pas tricher avec les secondes, a-t-il murmuré.
– Je ne triche pas. Je me contente de…
– De rester ici, alors que tu dois respirer dehors.
– Mais je…
– Tu m’as appris à nager, tu te souviens ? Tu disais : on ne retient pas son souffle pour traverser la mer. On respire, même si l’eau est froide.
– Je ne veux pas te perdre. Pas une deuxième fois.
– Je ne suis pas perdu.
Ses mots ont fait du bruit dans mon thorax. Je ne sais pas si c’était de la casse ou une réparation. J’ai voulu le serrer très fort. Il a accepté, ses bras autour de mon cou, son menton dans ma clavicule. Le parfum de sa peau m’est monté à la tête comme une musique d’enfance.
– Compte, a-t-il chuchoté.
J’ai fermé les yeux et j’ai compté. Un, deux, trois. Les chiffres sont devenus de la pluie. À sept mille, j’ai dit « sept » et la seconde s’est repliée sur elle-même avec un bruit de page. Il a disparu comme on souffle une allumette.
Je voulais arrêter. J’ai décidé de ne plus être chez moi à dix-neuf heures sept. Mais, où que je sois, quelque chose se figeait. Un pigeon suspendu au-dessus d’une miette, un chien au milieu d’un bond, un feu rouge éternel. Alors je rentrais en courant, haletante, honteuse de mon espoir, et j’ouvrais la porte à la volée. Il m’attendait, assis sur les marches, l’air fâché léger qu’il prenait quand il me voyait revenir.
– Tu ne peux pas vivre contre la marée, a-t-il dit un soir.
– Je peux apprendre.
– Non. Tu peux aimer. C’est différent.
Je me suis assise à ses pieds et j’ai posé la tête sur ses genoux. Il m’a raconté un rêve où il courait dans un champ blanc et où, à chaque pas, quelque chose fleurissait sous ses baskets. Des fleurs drôles, ridicules, des marguerites vertes, des jonquilles bleues. Il avait cette joie aux lèvres que je n’avais pas vue depuis longtemps.
Le lendemain, j’ai préparé un sac avec une serviette, un carnet, trois pommes. J’ai pris la voiture et je suis allée jusqu’à la mer. Je me suis assise sur le quai et j’ai écrit mon prénom sur la première page du carnet, puis le sien sur la seconde. Je les ai lus à haute voix, comme une prière. Le vent a répété en morceaux. J’ai attendu dix-neuf heures sept, exprès, face à l’horizon.
Rien ne s’est figé. Ou plutôt, tout s’est figé, mais d’une manière douce : la mer a suspendu sa respiration avec moi, le ciel a retenu un nuage. Je l’ai senti près de moi, sans le voir. Son rire m’a chatouillé l’oreille.
– Tu vois, a-t-il soufflé. Tu peux rester et partir en même temps.
Je n’ai pas répondu. J’ai posé la main sur l’eau. Elle était froide, vive. J’ai compté jusqu’à cent, lentement, pour le plaisir. À cent, j’ai replié le temps sur lui-même comme un origami et j’ai repris la voiture.
Les jours ont repris une forme de jours. J’ai recommencé à répondre au téléphone, parfois. J’ai écrit des listes de choses à ne pas oublier sur des Post-it que je collais parfois sur le frigo, parfois sur le miroir de la salle de bains.
Chaque soir, Octave venait. Parfois il parlait. Parfois il ne disait presque rien. Il me regardait faire semblant de ranger des choses, ou préparer un dîner pour deux dont un seulement mangerait. Parfois il me demandait une chanson. Je chantais faux, exprès. Il levait les yeux au ciel d’une manière si ridicule que je me sentais de nouveau mère.
– Il faudra qu’on se dise au revoir, a-t-il dit un jour.
– On l’a déjà fait.
– On doit le faire en vrai.
– Qu’est-ce que le vrai, dis-moi ?
– Le vrai, c’est quand tu peux sourire sans pleurer.
J’ai posé la main sur le calendrier. Le grand 7007 avait pâli. Il se dissolvait doucement à force d’être vu. J’ai pris le marqueur et j’ai écrit, tout petit, dans le coin du jour : « Respirer ». J’ai ajouté une flèche vers le lendemain.
– Je ne sais pas comment, ai-je confessé.
– Tu m’as appris.
– Je ne suis pas sûre d’avoir bien fait.
– Si. Tu as juste oublié pour toi.
Il a pris ma tasse et a avalé une gorgée de thé comme s’il pouvait en sentir le goût. Il a ri. Je me suis surprise à penser que j’aimerais savoir quelle tasse il préférerait à vingt-cinq ans, et puis j’ai trouvé que c’était une bonne pensée, pas une mauvaise.
– Tu veux essayer maintenant ? a-t-il demandé.
– Quoi ?
– Le vrai.
Le mot a claqué au milieu de la pièce. J’ai regardé autour comme si quelqu’un d’autre, plus adulte, allait répondre à ma place. Personne. J’ai ouvert grand les fenêtres. L’air du soir est entré. J’ai éteint la lumière. La maison s’est peuplée de bruits qu’elle gardait pour elle : le craquement du bois, la respiration du radiateur, le froissement d’un rideau. J’ai posé les mains sur son visage. Il était net et doux, terriblement vivant.
– Tu es prêt ? ai-je soufflé.
– Depuis la première fois. Et toi ?
– Non. Mais j’y vais quand même.
– C’est ça, vivre.
Nous nous sommes assis côte à côte, sans nous toucher, les yeux posés sur la pendule. La trotteuse a fait un pas et s’est arrêtée. Le silence s’est installé entre nous comme un lac. J’ai fermé les yeux. J’ai senti ses doigts effleurer les miens.
– Compte, a-t-il dit.
J’ai commencé. Un, deux, trois. J’ai volontairement ralenti. J’ai laissé chaque chiffre prendre sa respiration. À mesure que je comptais, des images sont venues : lui bébé dans la baignoire, ses genoux sales, son regard quand il a découvert la mer, sa colère de dix-sept ans qui le débordait comme un orage, son rire dans le soir, la dernière porte que j’ai fermée derrière lui, trop tard, toujours trop tard. Je n’ai pas fui. J’ai laissé tout passer à travers moi comme l’eau.
À 7000, j’ai ouvert les yeux. La pendule était toujours figée, et lui était là, entier. J’ai compris que je ne pouvais pas ajouter sept de plus sans mentir à ce que j’étais. Alors j’ai posé la main sur son cœur. Il battait. J’ai posé un baiser sur son front, très léger, comme on pose un caillou sur un cairn pour dire : je suis passée par là, et tu continues.
– Merci, ai-je dit.
– Merci, a-t-il répondu.
J’ai ajouté : quatre, cinq, six. J’ai gardé le sept au bord des lèvres. Je l’ai laissé là, comme une graine. Et puis j’ai soufflé.
Le monde a repris son souffle. La bouilloire a sifflé d’un coup, la mouette a achevé sa boucle. La pendule a fait un pas timide vers dix-neuf heures huit. Il n’était plus « ici », mais il n’était pas « parti ». Il était autrement, comme l’eau quand elle devient vapeur.
Sur le calendrier, j’ai écrit en grand, sur demain : « Respirer encore. »
J’ai souri. J’ai regardé la table. Le petit bateau de papier y était encore. Je l’ai pris. Je suis sortie sur le pas de la porte. La pluie avait repris, vraie, reconnaissable. J’ai posé le bateau dans la rigole au bord du trottoir, et je l’ai regardé partir, fragile et têtu, vers la mer.
Au loin, il m’a semblé entendre un rire qui me connaissait par cœur. J’ai répondu sans bruit. J’ai respiré.


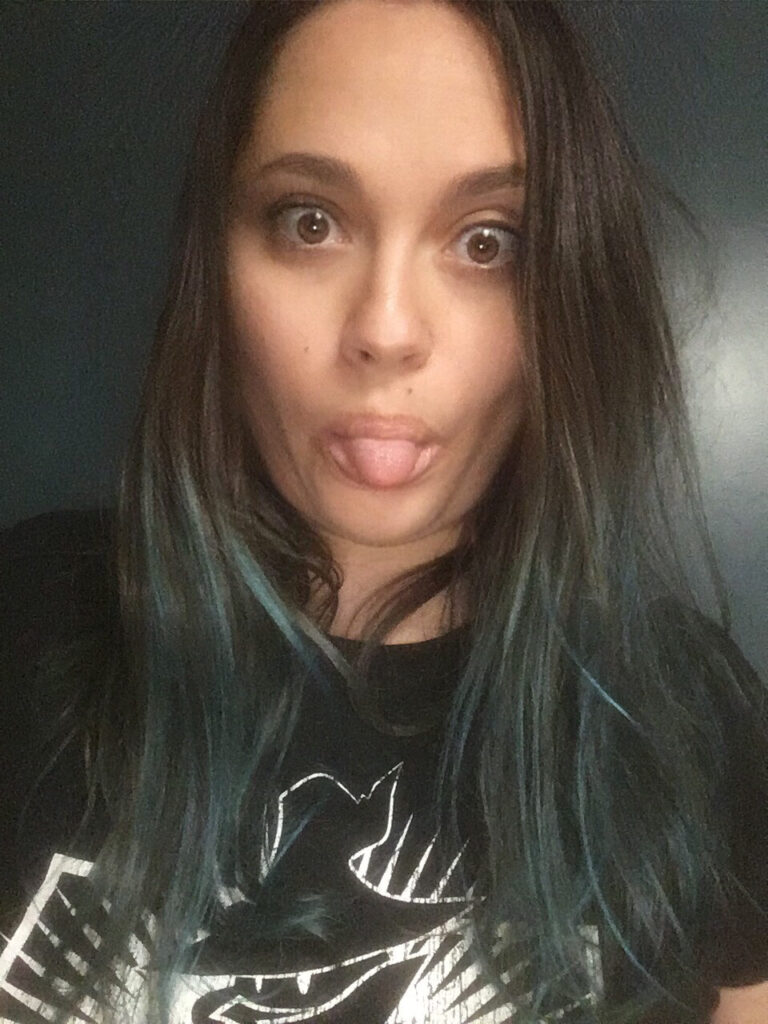
Bravo à ces trois auteurs. Des textes si différents mais aussi beaux l’un que l’autre, pour des raisons différentes.